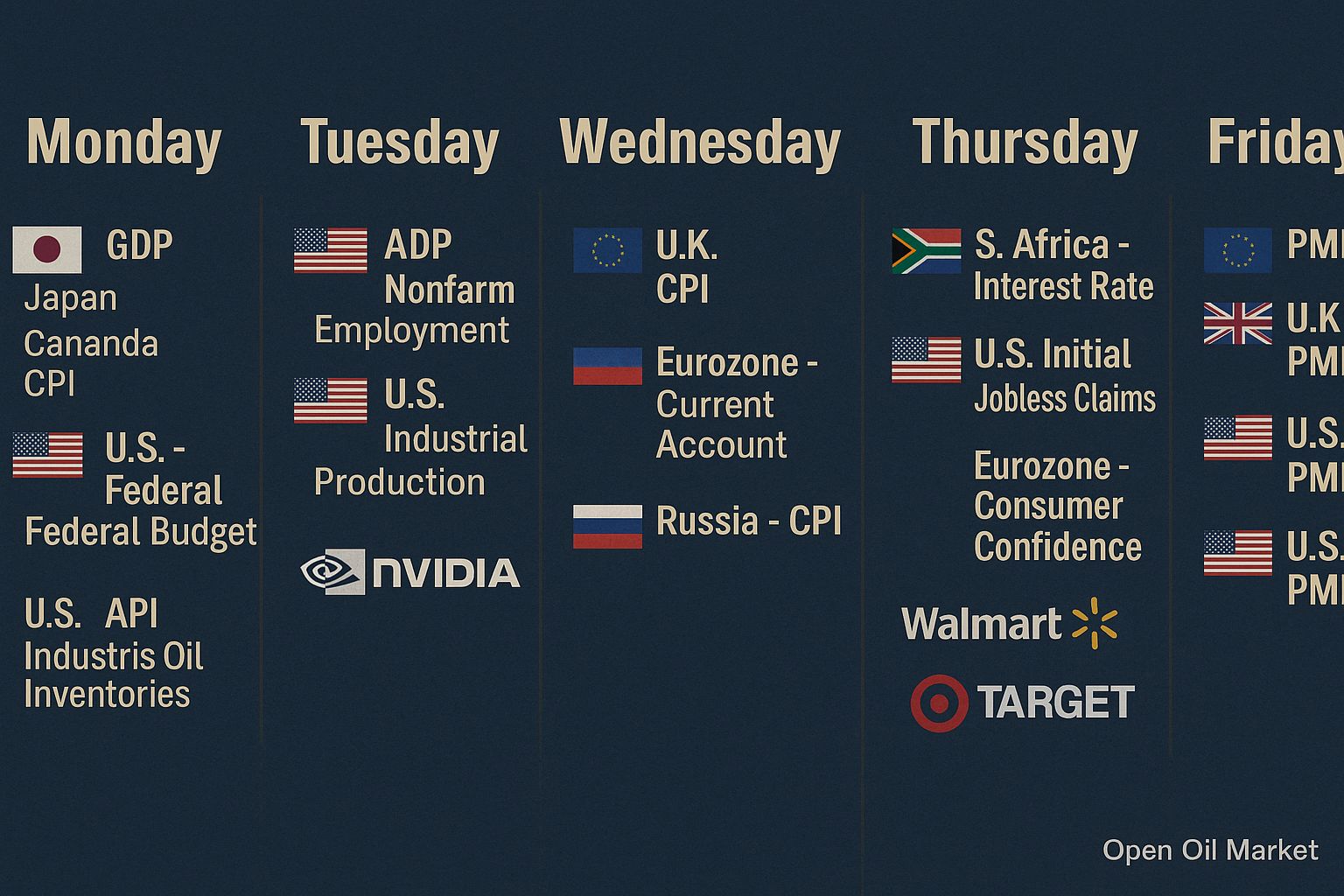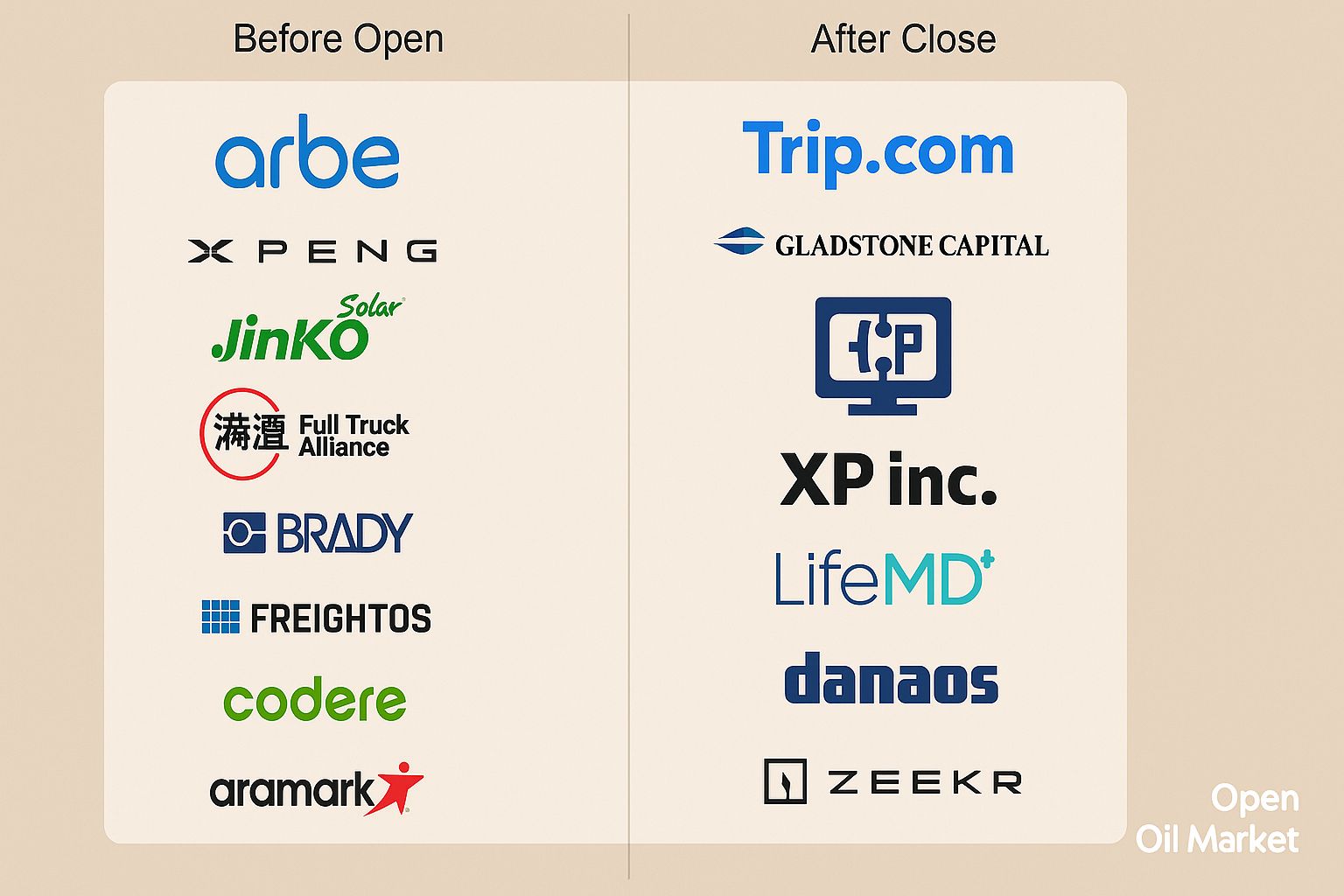Actualités du secteur de l'énergie pour le dimanche 12 octobre 2025 : chute des prix du pétrole due au cessez-le-feu et aux risques commerciaux, marché gazier confortable, demande stable de charbon, investissements records dans les énergies renouvelables et prolongation de l'interdiction d'exportation de combustibles en Russie. Aperçu complet de la situation sur le marché mondial de l'énergie.
Les événements récents du secteur de l'énergie au 12 octobre 2025 évoluent dans un contexte de signaux géopolitiques contrastés et de corrections sur les marchés. Le succès des négociations de cessez-le-feu au Moyen-Orient a quelque peu diminué la tension mondiale, mais l'opposition entre la Russie et l'Occident reste aiguë - les sanctions se multiplient et les négociations de paix stagnent. En même temps, les marchés des matières premières affichent une dynamique variée : les prix du pétrole ont chuté brusquement après des sommets récents, tandis que le marché du gaz entre dans l'hiver avec des réserves record et un calme relatif. La transition énergétique mondiale continue de prendre de l'ampleur - les investissements dans les énergies renouvelables battent des records, bien que les ressources traditionnelles (pétrole, gaz et charbon) jouent encore un rôle clé dans la fourniture mondiale d'énergie. En Russie, les autorités maintiennent un contrôle strict sur le marché intérieur des combustibles, prolongeant les restrictions à l'exportation dans le but de stabiliser les prix avant la période hivernale.
Ci-dessous se trouve un aperçu détaillé des principales nouvelles et tendances des marchés pétrolier, gazier, charbonnier, électrique et des énergies renouvelables à la date actuelle.
Marché pétrolier : le cessez-le-feu au Moyen-Orient et les tensions commerciales provoquent une chute des prix
À la fin de la semaine, les prix mondiaux du pétrole ont affiché une nette diminution après une hausse au cours des semaines précédentes. Le Brent de la mer du Nord est tombé en dessous de 63 dollars le baril, et le WTI américain a franchi pour la première fois depuis mai le seuil psychologique de 60 dollars, tombant à environ 59 dollars. Les cours actuels sont inférieurs de 8 à 10 % par rapport à il y a un mois et reflètent un ajustement brusque des risques sur le marché pétrolier. Plusieurs facteurs ont pesé sur les prix :
- Désescalade au Moyen-Orient : le progrès vers un cessez-le-feu entre Israël et Gaza a réduit significativement la prime géopolitique sur les prix pétroliers. Les craintes de ruptures d'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient se sont atténuées, affaiblissant ainsi le soutien au marché pétrolier qui avait auparavant maintenu les prix à des niveaux élevés.
- Confrontation commerciale États-Unis-Chine : la nouvelle escalade des tensions commerciales (menaces des États-Unis d'imposer de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises et les mesures de réponse de Pékin) a intensifié les inquiétudes sur les perspectives de l'économie mondiale. Les risques d'une guerre commerciale totale entre les deux plus grandes économies du monde ont accru l'incertitude et détérioré les prévisions sur la demande de ressources énergétiques, ce qui pèse également sur les cotations pétrolières.
- Augmentation de l'offre : les pays de l'OPEP+ continuent d'augmenter leur production conformément à un plan convenu. À partir d'octobre, le quota total des participants à l'accord a été augmenté d'environ 140 000 barils par jour (après une hausse plus significative le mois précédent). De plus, la Russie annonce une reprise rapide de sa production pétrolière, cherchant à tirer parti des prix relativement élevés des derniers mois. L'Administration de l'information sur l'énergie des États-Unis prévoit également une augmentation continue de la production de pétrole de schiste. L'augmentation globale de l'offre forme des signes d'un surplus de production par rapport à la demande sur le marché mondial.
- Facteurs saisonniers : la fin de la période estivale de forte demande et le début des réparations programmées dans les raffineries ont réduit la pression sur le marché des produits pétroliers. Au début de l'automne, la consommation d'essence (après la clôture de la saison automobile) et de kérosène d'aviation diminue traditionnellement, ce qui allège la pression sur les prix. Parallèlement, les arrêts préventifs de certaines raffineries limitent l'offre de combustibles, mais grâce aux réserves accumulées et aux mesures de substitution, cela suffit pour équilibrer le marché pour le moment.
En conséquence, à la mi-octobre, les cours pétroliers ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis plusieurs mois. Le Brent a perdu près de 6 dollars par rapport aux récents pics, affichant la plus forte baisse hebdomadaire de l'année. Cependant, le marché reste volatil et sensible aux nouvelles : les traders suivent de près l'évolution de la situation. En cas de détérioration de la situation géopolitique ou si la demande réelle dépasse les attentes, une nouvelle hausse des prix est possible. D'un autre côté, un surproduction persistante et le renforcement du dollar pourraient maintenir le pétrole dans une fourchette de prix relativement basse à court terme.
Marché gazier : l'Europe se prépare à l'hiver grâce à des stockage pleins
Sur le marché du gaz naturel, la stabilité prédomine. L'Union européenne entre dans la saison automne-hiver avec des réserves de gaz presque record et une demande modérée, ce qui limite la hausse des prix à l'approche de la saison de chauffage. Selon les données de Gas Infrastructure Europe, le niveau de remplissage du stockage souterrain (UGS) dans l'UE a dépassé 95 % - bien au-dessus de l'objectif fixé, assurant une solide réserve de sécurité en cas d'hiver rude. Les facteurs clés influençant le marché du gaz sont les suivants :
- Réserves élevées : grâce à une injection active pendant l'été, les UGS européens ont atteint des niveaux record pour octobre. Les réserves de gaz dans l'Union européenne sont actuellement environ de 5 à 7 % supérieures à l'année précédente à la même date. Le volume de combustible accumulé peut couvrir une part significative de la consommation hivernale, réduisant ainsi le risque de pénurie même en cas de froid anormal.
- Importations de GNL : l'Europe continue de recevoir des volumes stables de gaz naturel liquéfié. La baisse de la demande de GNL en Asie a libéré des cargaisons supplémentaires pour le marché européen, et les fournisseurs des États-Unis, du Qatar et d'autres pays utilisent au maximum l'infrastructure de réception de gaz. Un fort import de GNL compense la réduction des livraisons par pipeline en provenance de Russie et les réparations programmées sur les champs de la mer du Nord, maintenant le marché en équilibre.
- Demande modérée : un temps relativement doux au début de l'automne et une augmentation de la production d'électricité à partir de sources renouvelables limitent la consommation de gaz dans la production d'électricité. L'industrie européenne n'a pas encore retrouvé des niveaux de charge pré-pic, donc la demande globale de gaz reste inférieure à celle des années précédentes. Les centrales électriques de l'UE équilibrent souplement la charge entre le gaz et les énergies renouvelables, utilisant le gaz principalement comme réserve pour couvrir les pics, ce qui empêche également des pics de consommation de combustible.
- Prix et marché : les prix de gros du gaz en Europe (indice TTF) se maintiennent autour de 30 à 35 €/MWh - plusieurs fois inférieurs aux valeurs maximales de 2022. Fin septembre, les cotations étaient même brièvement tombées en dessous de 30 €/MWh grâce à des réserves élevées et à l'absence de panique sur le marché. La volatilité des prix reste modérée : les acteurs du marché sont convaincus que les réserves sont suffisantes et n'incorporent pas de sérieuse prime de risque dans les prix. Cependant, à l'approche de l'hiver, la courbe des prix pourrait remonter si un froid anormal se mettait en place en novembre-décembre ou s'il y avait des interruptions dans les approvisionnements en GNL vers l'Europe.
Ainsi, l'Europe aborde le début de la saison de chauffage considérablement mieux préparée que lors des années précédentes. Les réserves accumulées et la diversification des sources d'approvisionnement renforcent la résilience du marché gazier. Même en cas d'hiver rigoureux, le gaz stocké permettra d'atténuer les éventuels chocs. Toutefois, les analystes mettent en garde que des facteurs isolés (comme un anticyclone froid prolongé ou des imprévus sur les routes d'approvisionnement) peuvent encore provoquer des pics de prix temporaires, c'est pourquoi les entreprises énergétiques continuent de suivre attentivement les prévisions météorologiques et la situation des approvisionnements.
Politique internationale : confrontation par sanctions sans assouplissement
La situation géopolitique entourant les marchés énergétiques reste tendue. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, et aucun progrès n'a été réalisé dans les pourparlers de paix. Dans ce contexte, les pays occidentaux non seulement ne relâchent pas, mais renforcent aussi la pression des sanctions sur le secteur énergétique russe. À la fin septembre, l'Union européenne a introduit son 19e paquet de sanctions, visant à réduire davantage les revenus de Moscou issus de l'exportation de ressources énergétiques. Les nouvelles restrictions visent à fermer les dernières échappatoires : un embargo total sur le réexportation des produits pétroliers russes via des pays tiers est en discussion, ainsi qu'un renforcement du contrôle sur le respect du plafond de prix pour le pétrole de marque Urals, ainsi que des mesures supplémentaires dans le secteur financier.
Les États-Unis, de leur côté, continuent de suivre une ligne de contrôle strict du respect des régimes de sanctions. L'administration américaine appelle ses alliés à accélérer l'abandon du pétrole et du gaz russes, tout en prévenant des conséquences pour les entreprises aidant la Russie à contourner les restrictions. Ainsi, à la mi-automne, la confrontation par sanctions entre la Russie et l'Occident reste en vigueur sans signes d'atténuation : l'exportation énergétique de la Russie continue d'être soumise à des restrictions sévères, les entreprises occidentales évitent de nouveaux projets en Russie, et les transactions financières du secteur pétrolier et gazier russe sont sous un contrôle renforcé.
Moscou renforce contraint son pivot vers l'Est à la recherche de marchés pour ses produits et d'investissements. Les exportateurs russes redirigent le pétrole et les produits pétroliers vers l'Asie, offrant aux acheteurs indiens et chinois des réductions de prix et des conditions avantageuses. Ce faisant, la Russie essaie de maintenir sa part sur le marché mondial, malgré les sanctions, bien que cela entraîne une perte de revenus. En parallèle, le pays développe des systèmes de paiement alternatifs et des routes logistiques, essayant de minimiser sa dépendance à l'égard de l'infrastructure occidentale.
En dehors des sanctions, le secteur énergétique mondial commence également à ressentir les effets d'un conflit commercial exacerbé entre les États-Unis et la Chine. Bien que cela ne soit pas directement lié à l'énergie, des restrictions économiques mutuelles entre les plus grandes économies du monde augmentent l'incertitude générale. Les menaces d'imposition de nouveaux droits de douane et d'interdictions d'exportation créent des risques de ralentissement de l'économie mondiale, ce qui pourrait à terme se refléter sur la demande de ressources énergétiques. Par conséquent, les facteurs internationaux jouent actuellement un double rôle : d'une part, ils maintiennent une prime de risque élevée (liée aux sanctions et aux conflits locaux), d'autre part, ils commencent à peser sur le marché en raison des attentes de ralentissement économique dues aux guerres commerciales. Pour les investisseurs et les entreprises du secteur énergétique, cette tension géopolitique implique la nécessité de tenir compte en permanence des facteurs extra-économiques lors de la planification des activités.
Asie : l'Inde et la Chine augmentent leurs importations et diversifient leurs bilans énergétiques
Les plus grandes économies asiatiques - l'Inde et la Chine - continuent de jouer un rôle clé sur les marchés énergétiques mondiaux, misant sur la sécurité énergétique et un approvisionnement à long terme en ressources. En 2025, ces deux pays représentent la majeure partie de la croissance de la demande mondiale en hydrocarbures tout en investissant activement dans l'expansion de leur propre infrastructure énergétique.
- Inde : New Delhi maintient son cap sur une exploitation maximale de sources de matières premières bon marché. L'Inde est devenue l'un des principaux acheteurs de pétrole russe Urals, bénéficiant de remises importantes en raison des sanctions contre la Russie. Les importations de pétrole russe sont proches de niveaux record, alimentant les raffineries indiennes. Cela permet de couvrir entièrement les besoins internes du pays en produits pétroliers et même d'exporter les surplus. En même temps, l'Inde augmente ses importations de gaz liquéfié et de charbon, cherchant à diversifier son panier d'énergie et à éviter les pénuries de combustibles. Le pays investit dans l'expansion de l'infrastructure portuaire et des capacités de stockage, solidifiant ainsi son indépendance énergétique.
- Chine : Pékin continue de trouver un équilibre entre les besoins à court terme et les objectifs stratégiques. D'une part, la Chine augmente sa propre production de pétrole et de gaz naturel en investissant dans l'exploitation des gisements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. D'autre part, elle conclut activement de nouveaux contrats d'importation à long terme de ressources énergétiques. En 2025, les entreprises d'État chinoises ont signé des accords pluriannuels pour l'approvisionnement en GNL avec des producteurs du Moyen-Orient et des États-Unis, tout en augmentant les achats de pétrole en provenance des pays du Golfe Persique et de Russie. De plus, la Chine élargit ses réserves stratégiques de pétrole et de gaz, profitant des périodes de prix plus bas. Bien que l'économie chinoise ait légèrement ralenti, le pays reste le plus grand importateur mondial de ressources énergétiques, déterminant ainsi la conjoncture des prix par sa demande.
Les deux puissances asiatiques augmentent parallèlement leurs investissements dans les énergies renouvelables et l'infrastructure. Tant l'Inde que la Chine cherchent à accroître la part des générateurs solaires et éoliens, investissent dans la construction de centrales nucléaires et dans la modernisation des réseaux. Cependant, à court terme, leur bilan énergétique repose encore sur des hydrocarbures traditionnels - pétrole, gaz et charbon. Ces derniers constituent la base de leur croissance économique. L'engagement de l'Inde et de la Chine à garantir un approvisionnement ininterrompu pour leurs économies signifie que ces pays continueront de jouer un rôle actif sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz, profitant de toutes les opportunités pour acheter des ressources à des conditions favorables.
Charbon : une forte demande asiatique maintient la stabilité du marché
Le marché mondial du charbon en 2025 fait preuve d'une relative stabilité grâce à une demande soutenue en provenance d'Asie. Malgré les objectifs climatiques mondiaux et les efforts de réduction des émissions, le charbon continue de représenter une part significative dans le bilan énergétique de plusieurs grandes économies. Le rôle du charbon dans la production d'électricité des pays en développement est particulièrement important, ce qui soutient un niveau élevé de consommation de cette ressource.
- Leadership asiatique : les pays asiatiques, principalement la Chine et l'Inde, consomment ensemble environ 70 à 75 % du charbon mondial. La croissance économique rapide et les besoins d'une population de plusieurs milliards de personnes nécessitent d'énormes volumes d'électricité, et le charbon demeure une source fiable pour couvrir la charge de base. Par exemple, la Chine continue d'introduire de nouvelles centrales à charbon pour assurer une approvisionnement électrique stable, tout en augmentant également sa production d'énergies renouvelables.
- Dynamique des prix : après une hausse extrême des prix du charbon énergétique en 2022, le marché est revenu à des niveaux plus équilibrés. En 2025, les prix du charbon se maintiennent à un niveau modéré, bien en dessous des pics record. La demande en Asie est constamment élevée, mais l'augmentation de la production dans les pays exportateurs (Australie, Indonésie, Russie) et le remplacement du charbon par d'autres types de combustibles en Europe et aux États-Unis ont empêché une pénurie. En conséquence, le prix du charbon fluctue dans une fourchette confortable, suffisante pour rentabiliser les mines, mais sans imposer une pression excessive sur les importateurs.
- Réduction occidentale : en Europe, en Amérique du Nord et dans plusieurs autres régions, l'utilisation du charbon diminue progressivement. Une politique environnementale stricte, des quotas de carbone élevés et la concurrence du gaz naturel bon marché et des énergies renouvelables mènent à la mise hors service des centrales à charbon. Cependant, l'expérience de la crise énergétique de 2021-2022 a montré qu'un abandon rapide du charbon n'était pas réalisable - pendant les périodes de prix maximaux du gaz, certains pays européens ont temporairement augmenté la combustion de charbon pour éviter les blackouts. En 2025, l'Europe réduit de nouveau sa consommation de charbon grâce à la normalisation du marché gazier, mais conserve les centrales à charbon en réserve en cas de situations d'urgence.
Ainsi, le secteur du charbon maintient ses positions principalement grâce à l'Orient. Les perspectives à long terme de l'industrie restent prudentes - les investissements dans de nouveaux grands projets de charbon diminuent, et les institutions financières mondiales limitent le financement de l'industrie charbonnière. Cependant, au cours des prochaines années, la demande de charbon dans le monde en développement devrait rester, permettant à ce combustible fossile de traverser une période de transition jusqu'au déploiement complet de capacités alternatives accessibles.
Énergies renouvelables : investissements records et nouveaux défis de la transition
La transition énergétique mondiale en 2025 franchit une nouvelle étape. Les volumes d'investissement dans les énergies renouvelables battent des records historiques. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, les investissements mondiaux dans l'énergie solaire, éolienne et d'autres formes de production renouvelable dépasseront 2 trillions de dollars en 2025 - plus du double des investissements dans le secteur pétrolier et gazier pendant la même période. Un tel afflux de financements impulse une croissance rapide des capacités "vertes" dans le monde entier.
De nombreux pays se félicitent de nouveaux succès dans le domaine de l'énergie propre. En Europe, il y a eu plusieurs jours où plus de la moitié de l'électricité était produite grâce au vent et au soleil. En Chine, l'introduction de nouvelles fermes solaires et de parcs éoliens progresse à un rythme rapide, et le volume de production à partir des énergies renouvelables bat de nouveaux records chaque trimestre. Les États-Unis, malgré quelques fluctuations dans la politique de soutien, continuent également d'augmenter les capacités d'énergie renouvelable grâce aux capitaux privés et aux initiatives de certains États. Dans l'ensemble, la part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité est en constante augmentation, atteignant près d'un quart de l'ensemble du bilan énergétique (en incluant l'hydroélectricité - environ un tiers).
La croissance explosive des énergies renouvelables pose également de nouveaux défis pour le système énergétique. La saisonnalité et la variabilité de la production solaire et éolienne nécessitent le développement de systèmes modernes de stockage d'énergie et de solutions de réseau flexibles. En 2025, l'attention portée aux projets de clusters de batteries industrielles et de "réseaux intelligents" a augmenté. Les plus grandes économies investissent dans la construction de batteries de grande capacité pour lisser les pics et les creux de production, ainsi que dans des technologies digitales de gestion de la demande. Ces mesures sont indispensables pour maintenir la fiabilité de l'approvisionnement à mesure que la part des énergies renouvelables augmente et que la part de la production traditionnelle basée sur le charbon et le gaz diminue.
La politique gouvernementale demeure un moteur clé (ou un facteur restrictif) du développement de l'énergie propre. L'Union européenne met en œuvre de manière continue le "cursus vert", introduisant de nouveaux incitatifs pour les investisseurs - des subventions et des allégements fiscaux aux fonds ciblés de soutien aux projets climatiques. Dans d'autres pays, les tendances sont moins claires. Par exemple, aux États-Unis, la nouvelle administration a signalé une possible révision et réduction de certaines programmes de subvention pour l'énergie propre, invoquant des contraintes budgétaires. Cependant, même aux États-Unis, de nombreuses grandes entreprises et états poursuivent leur propre chemin vers les énergies renouvelables, en tenant compte des avantages économiques à long terme et des exigences de la société. Dans les pays en développement, les organisations financières internationales augmentent le financement des projets d'énergie renouvelable pour accélérer leur mise en œuvre.
En conclusion, les énergies renouvelables s'affirment comme une partie intégrante du paysage énergétique mondial. Chaque trimestre, de nouvelles capacités solaires et éoliennes sont mises en service, le coût de l'énergie propre diminue et les technologies de stockage s'améliorent. Bien que la transition vers une énergie carboneutre nécessite du temps et d'énormes investissements, la tendance demeure inchangée : la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique continuera à croître, tandis que la dépendance aux combustibles fossiles diminuera. Pour les entreprises énergétiques et les investisseurs, cela signifie qu'ils doivent adapter leurs stratégies : se concentrer sur l'innovation, améliorer l'efficacité et la durabilité environnementale devient le gage de la compétitivité dans cette nouvelle ère.
Marché russe : prolongation des restrictions à l'exportation et maintien de la stabilité intérieure
En Russie, à l'automne 2025, la situation sur le marché intérieur des combustibles reste au centre des préoccupations. Après une pénurie estivale de бензин et de diesel, causée par une combinaison de pic de demande saisonnier et de réduction de l'offre, le gouvernement continue de prendre des mesures d'urgence pour normaliser la situation. Au début d'octobre, les autorités ont prolongé la durée des restrictions précédemment établies sur l'exportation de produits pétroliers, cherchant à maintenir le maximum de volumes de combustibles sur le marché intérieur et à freiner la hausse des prix.
- Interdiction d'exportation de бензин : l'interdiction temporaire d'exportation de бензин automobile, introduite fin août, est maintenant prolongée jusqu'à la fin de 2025. Cette mesure s'applique à tous les producteurs et commerçants, à l'exception de livraisons limitées en vertu d'accords intergouvernementaux pour certains pays voisins. Le prolongement de cette interdiction totale vise à garantir une saturation suffisante du marché national en бензин, en particulier pendant la période de hausse de la demande d'automne et de préparation à l'hiver.
- Restrictions à l'exportation de diesel : l'interdiction partielle d'exportation de diesel reste également en vigueur. Les traders indépendants ne peuvent toujours pas exporter de diesel à l'étranger, tandis que les compagnies pétrolières disposant de leurs propres raffineries ne sont autorisées à procéder à des exportations limitées qu'avec le contrôle du gouvernement. Cette politique vise à diriger des volumes supplémentaires de diesel vers le marché russe, ce qui a déjà contribué à réduire les prix de gros après un pic en septembre.
- Mesures supplémentaires : dans le même temps, l'État a mobilisé des réserves et renforcé les mécanismes boursiers. Les compagnies pétrolières ont été enjointes d'augmenter les volumes de vente de combustibles sur la bourse SPbMTSB afin d'assurer une formation de prix transparente et de donner la priorité aux consommateurs nationaux. L'introduction d'une taxe d'exportation de protection, qui augmenterait automatiquement lorsque les prix intérieurs du gazole dépasseraient un certain niveau, est également discutée. Ces mesures visent à éviter la répétition de la situation de crise dans les stations-service et à créer un mécanisme à long terme pour stabiliser le marché des produits pétroliers.
Grâce à ces mesures, la situation s'améliore progressivement. Selon les déclarations du vice-premier ministre Alexandre Novak, au début d'octobre, les prix de gros pour бензин et diesel en Russie ont cessé de croître, et dans certaines régions, ils ont même commencé à diminuer au fur et à mesure de la saturation du marché. La fin de la campagne de récolte a réduit la charge saisonnière sur l'approvisionnement en combustibles, et la reprise des opérations de plusieurs raffineries après des arrêts imprévus (causés par des accidents et des attaques de drones l'été dernier) a augmenté l'offre de produits pétroliers. Dans la plupart des régions de la Fédération de Russie, le combustible est désormais disponible sans interruptions significatives, bien que des problèmes ponctuels subsistent dans des zones éloignées.
Le gouvernement souligne que le maintien de prix stables et de la disponibilité de combustibles pour les consommateurs nationaux est une priorité avant l'hiver. Les restrictions à l'exportation ne pourront être révisées qu'après une saturation convaincante du marché intérieur et la création de stocks. Pour les compagnies pétrolières, cette situation signifie une réduction temporaire des revenus d'exportation, mais les autorités sont prêtes à compenser partiellement les pertes via des mécanismes de stabilisation et des subventions. En fin de compte, le marché pétrolier russe entre dans l'automne sous surveillance et régulation, ce qui doit répondre aux besoins de l'économie et des citoyens en ressources énergétiques, même dans un contexte de restrictions extérieures et de volatilité des prix mondiaux.