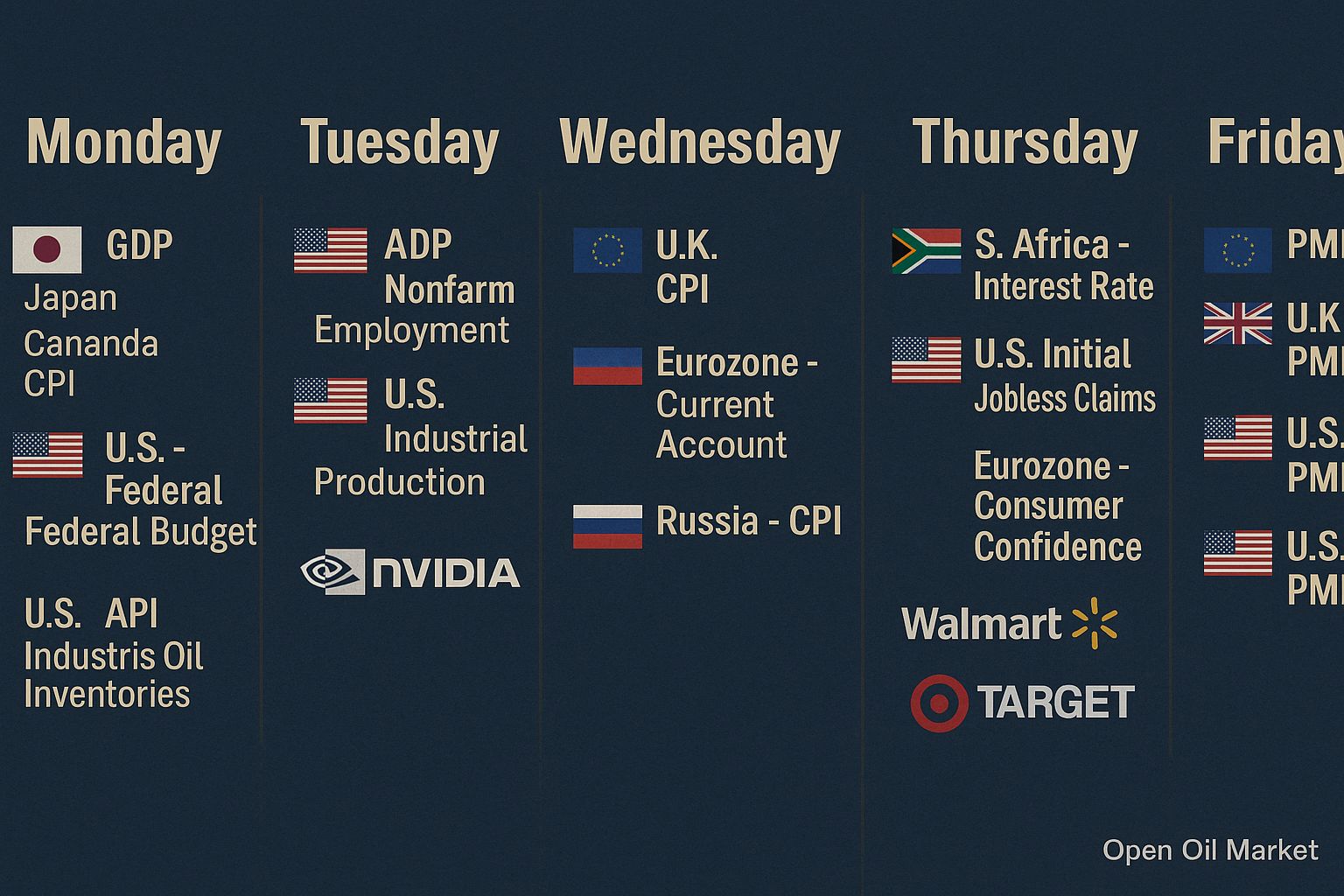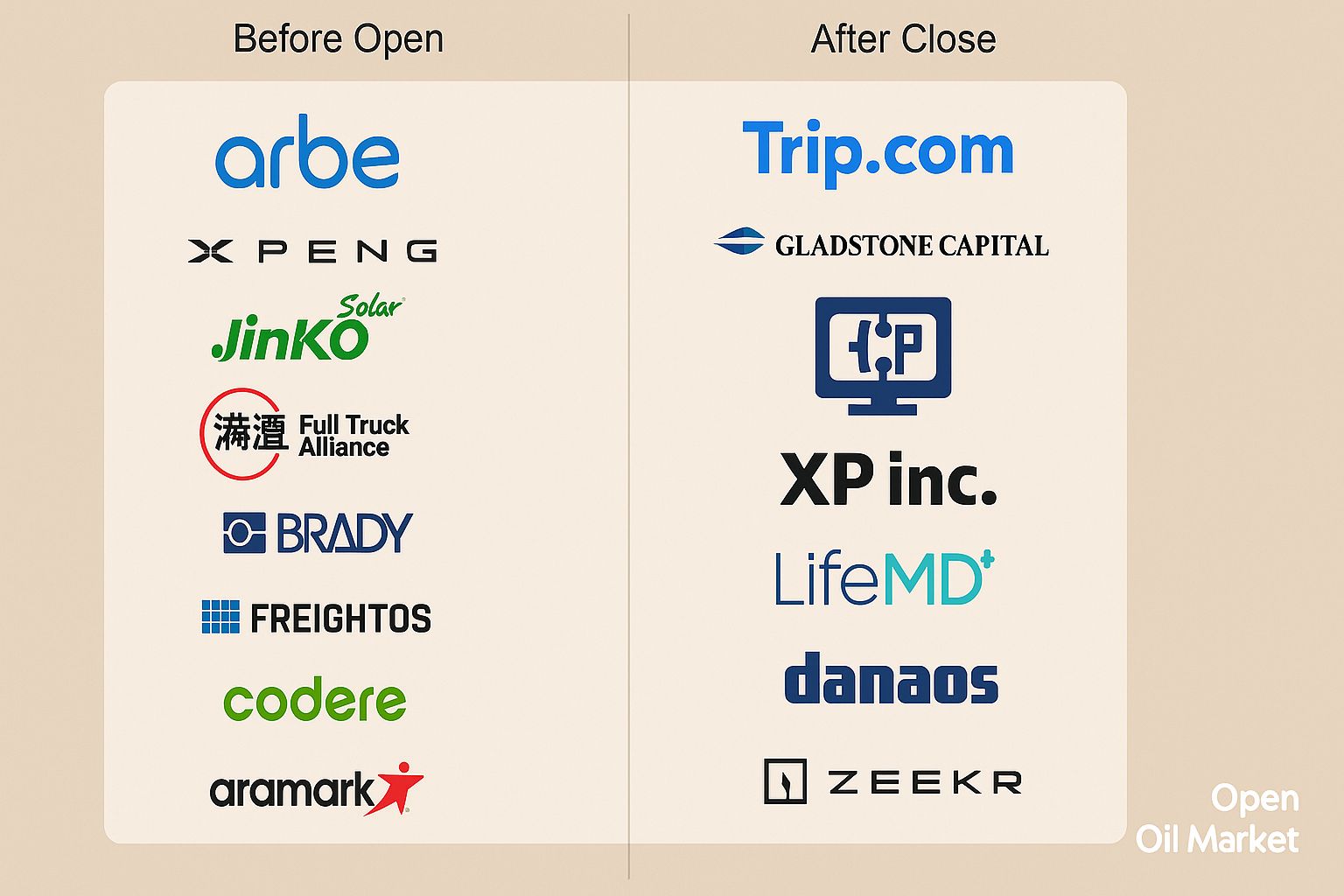Actualités du secteur énergétique au 13 octobre 2025 : stabilisation du marché des carburants en Russie, pression des sanctions sur le secteur pétrolier et gazier, investissements record dans les énergies renouvelables et préparation à la Semaine de l'énergie en Russie. Analyse par Open Oil Market.
La première moitié d'octobre se caractérise par la poursuite des efforts de normalisation du marché intérieur des carburants en Russie, suite à la récente crise, ainsi que par des mouvements significatifs sur les marchés mondiaux des matières premières. Les prix du pétrole demeurent sous pression en raison des attentes d'une surproduction, tandis que les sanctions occidentales à l'encontre du secteur énergétique russe se renforcent, affectant les flux commerciaux. Le marché européen du gaz aborde l'hiver avec des réserves record, ce qui contribue à la stabilité, et en même temps, l'industrie se prépare à un événement clé : la Semaine de l'énergie en Russie à Moscou. Voici un aperçu des événements récents dans le secteur énergique, importants pour les investisseurs, les participants du marché, ainsi que les entreprises pétrolières et gazières.
Stabilisation du marché des carburants en Russie : mesures gouvernementales et premiers résultats
Après le pic de pénurie d'essence en septembre, la situation sur le marché intérieur des carburants a commencé à se stabiliser progressivement. Dans plusieurs régions, les restrictions les plus sévères concernant la distribution de carburants ont été levées, et les stations-service indépendantes reprennent partiellement leurs activités normales. Les prix de gros des produits pétroliers, qui avaient atteint des sommets historiques, ont été ajustés à la baisse grâce aux mesures d'urgence du gouvernement russe. Cependant, les régions éloignées des grandes raffineries (Extrême-Orient, certaines régions de Sibérie) continuent d'éprouver une certaine tension en matière d'approvisionnement, et les autorités maintiennent la situation sous contrôle.
- Mesures d'urgence et importations : Le gouvernement a prolongé l'interdiction d'exportation d'essence automobile jusqu'à la fin de 2025, et les restrictions sur l'exportation de diesel pour les traders indépendants restent en vigueur. Ces mesures visent à rediriger le maximum de produits pétroliers vers le marché intérieur. Parallèlement, des mesures pour attirer du carburant de l'extérieur sont envisagées : par exemple, l'annulation des droits d'importation est discutée pour faciliter l'importation d'essence et de diesel des pays voisins (par exemple, des raffineries biélorusses) pour couvrir les pénuries dans les régions éloignées.
- Amortisseur et contrôle des prix : À partir du 1er octobre, un moratoire a été imposé sur l'annulation de l'amortisseur de carburants – l'État a temporairement levé le seuil de variation des prix, au-delà duquel les paiements aux raffineurs cessaient. Cette mesure signifie que les entreprises pétrolières continueront à recevoir des compensations pour les livraisons sur le marché intérieur, même si les prix de gros dépassent les niveaux indicatifs. Le mécanisme de l'amortisseur dans sa version révisée devrait rétablir la motivation économique pour fournir de l'essence et du diesel dans les stations-service du pays. Simultanément, le Service fédéral antimonopole (FAS) et le ministère de l'Énergie ont renforcé le contrôle des prix des carburants : des avertissements ont été émis à plusieurs stations-service pour hausse injustifiée des prix, et les contrevenants s'exposent à des amendes et à des ordres de baisse des prix à la pompe.
- Premiers résultats : À mesure que les réparations impromptues des raffineries se terminent et que les volumes d'exportation sont redirigés vers le marché intérieur, la pénurie de carburant moteur est progressivement réduite. En Russie centrale et dans plusieurs autres régions touchées, début octobre, une augmentation des livraisons en gros a commencé, permettant de reconstituer les stocks dans les stations-service. Le gouvernement s'attend à ce que l'ensemble des mesures prises permette d'entrer dans la période hivernale sans interruptions aiguës de l'approvisionnement, bien que la situation nécessite encore un suivi constant.
Marché pétrolier : décision de l'OPEP+, pression de l'offre et risques de sanctions
Le marché mondial du pétrole montre en début octobre une relative stabilité des prix, suivie d'une phase de baisse après des pics récents. Après la réunion de l'OPEP+ du 5 octobre, il a été annoncé que l'alliance avait confirmé un plan d'augmentation modérée de la production – environ +137 000 barils par jour à partir de novembre. Cela poursuit la politique de modération des quotas, dont l'objectif est de restaurer progressivement sa part de marché sans faire chuter les prix. Dans ce contexte, les cotations de Brent se maintiennent en moyenne autour de 63 à 65 dollars le baril, ce qui est largement inférieur aux sommets de l'année (environ 80 dollars). Le pétrole américain WTI est tombé dans la fourchette de 58 à 60 dollars. Les investisseurs font preuve de prudence : les attentes d'une surproduction se renforcent au quatrième trimestre 2025, ce qui pèse sur les prix.
- Croissance limitée de la production : Bien que l'OPEP+ ait officiellement augmenté le quota global, l'augmentation réelle de l'offre sera contenue. De nombreux pays de l'alliance approchent de leurs capacités de production maximales, donc même l'augmentation autorisée de ~0,14 million de barils par jour n'élargira que légèrement la production réelle. Cependant, les actions coordonnées du cartel envoient un signal au marché de maintenir l'équilibre : il est prévu que, sans chocs, Brent reste dans la fourchette de 60 à 70 dollars le baril dans les prochaines semaines.
- Excédent d'offre et demande : Les analystes avertissent d'une forte probabilité de formation d'un excédent de pétrole sur le marché mondial d'ici la fin de l'année. La croissance économique en Chine et en Europe ralentit, tandis que la production dans les pays non membres de l'OPEP (principalement aux États-Unis) augmente à un rythme accéléré. L'Agence EIA prévoit que le prix moyen du Brent en 2025 sera d'environ 68 dollars le baril, soit de 10 à 15 % de moins que l'année précédente. Le marché prend en compte ces attentes : les cotations du pétrole sont actuellement environ 20 % inférieures aux sommets du printemps. Si les prévisions d'offre se réalisent, la pression sur les prix pourrait continuer jusqu'en 2026.
- Sanctions et géopolitique : Le renforcement de la pression des sanctions crée des risques supplémentaires pour le marché pétrolier. Après l'introduction, au milieu de l'année, du 18e paquet de sanctions de l'UE, incluant la réduction du plafond de prix du pétrole russe à 47,6 dollars le baril, les pays occidentaux discutent de nouvelles restrictions. Washington appelle ses alliés à travailler à un abandon complet des sources d'énergie russes et à renforcer la lutte contre l'évasion des sanctions (par exemple, via une « flotte ombre » de tankers). Tout durcissement des sanctions est capable de réduire l'offre mondiale disponible, ce qui pourrait inverser soudainement la tendance des prix. De plus, des foyers d'instabilité demeurent : les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l'Est menacent la production ou l'exportation de pétrole. Malgré la faiblesse actuelle des prix, le facteur de prime géopolitique reste à l'ordre du jour et pourrait se manifester en cas d'escalade.
- Exportations russes et nouveaux marchés : Pour l'instant, les sanctions n'ont pas entraîné une chute brutale des exportations de pétrole de la Russie. Les entreprises pétrolières russes ont réussi à rediriger les principaux volumes vers l'Asie. L'Inde et la Chine restent les plus gros acheteurs : selon les estimations des traders, jusqu'à un tiers des besoins de l'Inde en pétrole sont désormais couverts par des matières premières russes. De plus, un flux croissant de fournitures russes se dirige vers la Turquie, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Cette géographie des ventes soutient les revenus des pétroliers russes et atténue partiellement le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché mondial. Cependant, en cas de durcissement ultérieur des sanctions (comme l'imposition de restrictions secondaires ou de taxes), ce canal de vente pourrait se réduire, ce qui constituerait un défi pour le secteur énergétique russe.
Gaz naturel : réserves confortables en Europe et réorientation des flux russes
Le marché mondial du gaz présente une situation favorable avant l'hiver. L'Union européenne entre dans la saison de chauffage avec des réserves record : les installations de stockage souterrain (ASS) des pays de l'UE sont en moyenne remplies à plus de 95 % de leur capacité maximale. Cela est nettement supérieur au niveau de l'année précédente et offre une marge de sécurité en cas de froid. Les prix de gros du gaz en Europe restent relativement bas – l'indice TTF fluctue entre 30 et 35 €/MWh, ce qui est plusieurs fois inférieur aux pics de l'automne 2022. La combinaison de réserves élevées et d'une demande modérée maintient le marché stable.
- Ressources pleines et GNL : Le temps clément et les efforts d'économie d'énergie durant l'été ont permis aux pays européens d'atteindre presque un taux de remplissage maximum de l'ASS sans achats d'urgence. Un rôle considérable a été joué par l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) : en raison d'une demande relativement faible de gaz en Asie, d'importantes quantités de GNL ont été redirigées vers l'Europe. Cela a compensé la diminution des approvisionnements par pipeline en provenance de Russie. Ainsi, à l'approche de l'hiver, la sécurité énergétique européenne apparaît plus robuste que jamais. Même en cas de refroidissement, l'Europe disposerait de réserves suffisantes pour éviter des hausses de prix extrêmes au cours des prochains mois.
- Refus complet du gaz russe : Les pays de l'UE poursuivent leur politique de réduction de la dépendance au gaz russe. Les approvisionnements directs par pipeline en provenance de la Russie ont été réduits à des volumes minimaux et ne subsistent que dans certains États (comme la Hongrie), basés sur des contrats à long terme. Parallèlement, la Commission européenne prépare un 19e paquet de sanctions, proposant pour la première fois de légaliser l'abandon progressif du GNL russe. Il est prévu de cesser complètement les achats de gaz russe sous toutes ses formes d'ici 2026–2027. Cette décision politique est déjà en grande partie mise en œuvre par le marché : la part du gaz russe dans les importations de l'UE a chuté d'environ 40 % à moins de 15 % en deux ans. Les achats restants (y compris le GNL en France, en Belgique et en Espagne) font l'objet de pressions de l'opinion publique et seront probablement réduits à zéro dans les années à venir. Un embargo complet sur le gaz russe priverait Gazprom d'un marché clé et inciterait l'Europe à accélérer le développement de sources alternatives et d'infrastructures (nouveaux terminaux de GNL, pipelines en provenance d'Afrique, etc.).
- Virage asiatique de la Russie : En réponse à la perte de la direction européenne, la Russie réoriente ses exportations de gaz vers l'Est. Les livraisons via le gazoduc « Force de Sibérie » vers la Chine continuent d’augmenter et atteindront des niveaux records en 2025 (prévision de plus de 22 milliards de mètres cubes par an). Parallèlement, Moscou négocie la construction d'un second gazoduc principal vers la Chine à travers la Mongolie (« Force de Sibérie – 2 »), qui pourrait partiellement compenser la perte du marché européen d'ici la fin de la décennie. Il est également question d'élargir la coopération avec la Turquie : le modèle de « hub gazier » en Turquie suppose qu'une partie du gaz russe puisse être vendue en Europe comme étant turc, contournant formellement les restrictions sur les sanctions. Cependant, ces projets nécessitent du temps et des investissements. À court terme, les exportations de gaz de la Russie resteront en deçà des niveaux d'avant la pandémie, tandis que l'accent est mis sur le maintien d'une fourniture stable aux consommateurs intérieurs et aux partenaires des États de la CEI. Par exemple, la Russie et la Biélorussie ont récemment prolongé l'accord sur les approvisionnements en gaz à des conditions préférentielles pour 5 ans, assurant la prévisibilité des prix pour leurs alliés.
Électricité : consommation record et modernisation des infrastructures
La consommation mondiale d'électricité continue d'établir de nouveaux records en 2025. La croissance économique et les changements technologiques stimulent l'augmentation de la demande d'électricité dans tous les secteurs. Les prévisions indiquent qu'à la fin de l'année, le volume total de production d'électricité dans le monde dépassera les 30 000 TWh – un maximum historique. Les principales contributions viennent des économies majeures : aux États-Unis, la consommation devrait atteindre environ 4,1 trillions de kWh (un nouveau record absolu), en Chine, plus de 8,5 trillions de kWh. Dans les pays en développement d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, la consommation d'énergie augmente également rapidement grâce à l'industrialisation et à la croissance de la population. Cette ampleur de la demande ouvre à la fois de nouvelles opportunités pour les entreprises énergétiques et pose des défis complexes pour les systèmes énergétiques.
- Pression sur les réseaux : La croissance sans précédent de la consommation d'électricité nécessite une modernisation accélérée de l'infrastructure. Dans de nombreux pays, d'importants programmes d'investissement ont été annoncés pour élargir et moderniser les réseaux électriques, construire des capacités de production supplémentaires. L'objectif est d'éviter des pénuries de capacité et de prévenir les interruptions de courant lors de charges de pointe. Par exemple, dans plusieurs États américains, les entreprises énergétiques investissent des milliards de dollars pour renforcer les réseaux en raison du boom de la demande provenant des centres de données et des stations de recharge pour véhicules électriques. En Chine, un plan national pour les « réseaux intelligents » est mis en œuvre afin d'intégrer la quantité croissante de génération renouvelable et d'assurer la fiabilité du transport sur de longues distances. En Russie et dans les pays de la CEI, la croissance de la consommation est plus modérée (environ +2 à 3 % par an), mais les facteurs géopolitiques dictent la nécessité de réserves de robustesse : les exportations d'électricité de la Russie ont diminué, et la génération interne et les réseaux s'adaptent aux nouvelles conditions. Le gouvernement russe met l'accent sur l'amélioration de la fiabilité de l'approvisionnement électrique pour les régions éloignées et la modernisation des installations du Système énergétique unifié.
- Efficacité énergétique : L’une des clés pour équilibrer l’offre et la demande est l’amélioration de l’efficacité énergétique. Dans un contexte de prix élevés des sources d'énergie et d'agenda climatique, de nombreux pays mettent en œuvre des programmes visant à réduire les pertes et à passer à des équipements plus économes. De l'industrie à l'habitat, des technologies modernes (éclairage LED, moteurs à haut rendement, « maisons intelligentes ») sont mises en place pour contenir la croissance de la consommation sans compromettre le développement économique. Ces mesures sont particulièrement pertinentes pour l'UE, où la demande record d'électricité coïncide avec une politique de décarbonisation – l'utilisation efficace de l'énergie permet d'éviter la surcharge du réseau et de réduire les émissions de CO₂.
Énergies renouvelables : investissements record et expansion de la part des ENR
Le secteur des énergies renouvelables continue de croître de manière impressionnante en 2025, confirmant la tendance mondiale vers une transformation « verte » du secteur énergétique. Les investissements dans les technologies solaires, éoliennes et autres énergies propres battent des records historiques : rien que pour le premier semestre 2025, environ 400 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'énergies renouvelables dans le monde – une hausse de 10 à 12 % par rapport à la même période l'année précédente. Ce capital est principalement dirigé vers la construction de nouvelles centrales solaires et éoliennes, ainsi que vers le développement d'infrastructures de stockage d'énergie (batteries industrielles) et la modernisation des réseaux pour intégrer la production décentralisée. Grâce à ces investissements, de nouvelles capacités sont installées, permettant d'augmenter la production d'électricité sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
Les statistiques confirment des taux de croissance élevés : selon les estimations du secteur, au premier semestre 2025, environ 380 GW de nouvelles centrales solaires ont été installées dans le monde – presque 1,7 fois plus que l'année précédente. Des mégaprojets en Chine, en Inde, au Moyen-Orient et aux États-Unis ont contribué de manière significative. L'énergie éolienne également connaît un essor : d'importants parcs éoliens offshore ont été mis en service au large des côtes du Royaume-Uni, de la Chine, du Vietnam et d'autres pays, ajoutant des dizaines de gigawatts de capacité. Ces réalisations ont conduit à ce que la part cumulative des ENR dans la production mondiale d'électricité atteigne un nouveau sommet.
- Augmentation de la part de l'énergie propre : Les sources d'énergie renouvelables occupent progressivement une part de plus en plus significative dans le bilan énergétique. En moyenne dans le monde, les ENR représentent désormais environ 30 % de la production d'électricité. Dans l'Union européenne, ce chiffre dépasse 45 % grâce à une politique active de « transition verte » et à la suppression rapide des centrales au charbon. La Chine s'approche de la barre des 30 % de production d'ENR, en dépit de l'énorme échelle de son système énergétique et de la poursuite de la construction de nouvelles centrales au charbon. Selon les analystes, au premier semestre 2025, la production d'électricité à partir du solaire et de l'éolien a pour la première fois dépassé la production à partir du charbon – un événement significatif pour l'énergie mondiale.
- Soutien gouvernemental au secteur : Les gouvernements des principales économies renforcent les incitations pour le développement des énergies renouvelables. Dans l'UE, de nouveaux objectifs climatiques ont été mis en place, nécessitant une rapidité accrue dans l'introduction des capacités propres et l'élargissement des échanges de certificats verts. Aux États-Unis, la mise en œuvre d'un programme de subventions et d'allégements fiscaux pour les fabricants d'équipements et les investisseurs dans les ENR se poursuit (dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, IRA). Les pays de la CEI ne restent pas à l'écart : en Russie et au Kazakhstan, de nouveaux appels d'offres pour des projets solaires et éoliens ont été annoncés, l'Ouzbékistan met en œuvre des plans ambitieux pour la construction de parcs solaires dans des régions désertiques. Le soutien gouvernemental vise à assurer un flux d'investissements futurs et à réduire les coûts du secteur, rendant l'énergie « verte » attrayante pour les entreprises.
- Points problématiques : La croissance rapide des ENR est également accompagnée de défis. La forte demande pour les équipements et les matériaux (par exemple, le silicium polycristallin pour les panneaux solaires) crée des tensions dans les chaînes de production et entraîne une augmentation des coûts des projets. Le secteur fait face à un manque de compétences qualifiées pour la construction et l'exploitation de centaines de nouvelles installations. De plus, les systèmes énergétiques ont besoin de flexibilité : l'intégration d'un grand volume de production variable (solaire et éolien) nécessite le développement de systèmes de stockage d'énergie et de gestion intelligente de la charge. Malgré ces difficultés, l'orientation mondiale vers la décarbonisation reste claire – les experts prévoient que dans les prochaines années, les investissements dans les ENR continueront de croître, et la part de l'énergie propre dans le bilan continuera de battre des records.
Charbon : demande asiatique contre politique de sortie du charbon
Le marché mondial du charbon en 2025 montre une dynamique mixte. D'une part, la demande de charbon a temporairement augmenté dans certaines régions. Cet été, une poussée d'importation de charbon énergétique par les pays d'Asie de l'Est a été enregistrée : par exemple, en août, les achats de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud ont augmenté de près de 20 % par rapport au mois précédent. Cela est dû à des facteurs internes – en Chine, en raison d'un renforcement de la sécurité et de vérifications écologiques, la production de charbon a temporairement diminué, tandis que la demande industrielle en électricité a rapidement rebondi. La production manquante en République populaire de Chine a été compensée par le biais d'importations supplémentaires de charbon, ce qui a fait grimper les prix régionaux : les cotations du charbon australien Newcastle ont dépassé 110 dollars la tonne (un maximum des cinq derniers mois). De même, l'Inde et plusieurs autres pays asiatiques ont augmenté leur consommation de charbon pour stabiliser leurs systèmes énergétiques.
D'autre part, la tendance à long terme reste défavorable pour l'industrie du charbon. De nombreux États poursuivent une politique de désengagement progressif de l'utilisation du charbon à des fins environnementales et dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Dans l'Union européenne, la part de la production d'électricité à partir du charbon est déjà tombée en dessous de 10 % (contre environ 15 % il y a quelques années). Onze pays de l'UE ont officiellement annoncé des plans pour fermer complètement toutes les centrales au charbon d'ici 2030, en les remplaçant par des installations au gaz et renouvelables. Aux États-Unis, bien que des initiatives aient été formulées au niveau fédéral pour soutenir l'industrie charbonnière (attribution de subventions pour la modernisation des mines et prolongation de l'exploitation de certaines centrales pour des raisons de sécurité énergétique), les conditions du marché demeurent difficiles : le gaz naturel bon marché et la hausse des ENR rendent le charbon moins compétitif. Même dans les économies traditionnellement « charbonnières », la consommation diminue : l'Allemagne, qui avait temporairement augmenté la combustion de charbon en 2022-2023 en raison de la crise gazière, a de nouveau réduit la production dans ses centrales au charbon en 2025.
- Restructuration des flux d'exportation : Pour la Russie, l'un des plus grands exportateurs de charbon, les changements sur le marché mondial signifient une réorientation des ventes. Suite à l'embargo de l'UE sur le charbon russe (depuis mi-2022), les entreprises charbonnières russes ont réorienté les principaux volumes vers l'Asie. Aujourd'hui, plus de 75 % des exportations de charbon russe vont vers la Chine, l'Inde, la Turquie et d'autres pays de la région Asie-Pacifique. Cette demande compense partiellement la perte du marché européen, même si la rentabilité des ventes est plus basse en raison des coûts logistiques et des remises accordées aux acheteurs asiatiques. À l'avenir, à mesure que les grandes économies mondiales réduisent leur dépendance au charbon, les charbonniers russes devront s'adapter – développer une transformation plus approfondie du charbon, chercher de nouvelles niches (comme le charbon métallurgique) ou réduire la production dans les mines moins rentables.
- Engagements climatiques : Le virage mondial vers l'énergie exerce une pression sur l'industrie du charbon. De plus en plus de pays rejoignent des initiatives de réduction des émissions : des taxes carbone sont mises en place, des mécanismes de réglementation transfrontaliers sont créés (CBAM dans l'UE), et les institutions financières limitent le financement des projets charbonniers. Ces facteurs conduisent déjà à une presque absence d'investissements dans de nouvelles capacités charbonnières en dehors des pays en développement. Pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, les experts de l'Agence internationale de l'énergie recommandent que le pic de consommation mondiale de charbon ait déjà été atteint et anticipent une baisse continue de la demande dans les prochaines décennies. Dans un tel environnement, les programmes gouvernementaux de soutien à l'industrie charbonnière (comme aux États-Unis ou en Chine) sont de nature temporaire et rencontrent des critiques de la part des écologistes.
Prévisions et attentes : focus sur le forum énergétique et la saison hivernale
Le début du quatrième trimestre 2025 génère des attentes mixtes parmi les participants au marché du secteur énergétique. D'une part, les efforts entrepris pour stabiliser permettent d'espérer une amélioration progressive de la situation – notamment sur le marché intérieur des carburants en Russie, où les effets des mesures gouvernementales commencent déjà à se faire sentir. D'autre part, de nombreuses incertitudes persistent.
- Semaine de l'énergie russe : À Moscou, du 15 au 17 octobre, se tiendra le forum « Semaine de l'énergie russe 2025 », qui sera la plateforme centrale pour discuter de la stratégie de développement du secteur énergétique. Des interventions des dirigeants du pays et des plus grandes entreprises énergétiques sont attendues, portant sur l'adaptation du secteur aux conditions de sanctions, la promotion des exportations vers des États amis et le développement de nouveaux projets (GNL, pétrochimie, ENR). Les investisseurs et les analystes prêteront une attention particulière aux déclarations lors du forum – celles-ci donneront le ton au marché pour les mois à venir et clarifieront les orientations des politiques publiques face à la pression externe.
- Facteur hivernal : La saison de chauffage s'annonce dans l'hémisphère nord. Un hiver clément pourrait consolider la stabilité actuelle sur les marchés du gaz et de l'électricité : avec des températures modérées, des réserves de gaz élevées en Europe et des stocks de carburant accumulés permettront de passer l'hiver sans chocs de prix. Cependant, un temps extrêmement froid pourrait de nouveau créer du stress pour les systèmes énergétiques – la demande de gaz, d'électricité et de charbon augmentera, ce qui pourrait entraîner des hausses de prix même avec des stocks pleins. Les marchés prennent en compte ces risques dans les prévisions : la volatilité des prix des énergies pourrait, à court terme, augmenter en cas d'anomalies météorologiques.
- Conditions monétaires et économiques : L'environnement financier mondial influence également le secteur énergétique. La hausse des taux d'intérêt et les signes de ralentissement économique dans certains pays peuvent réduire l'activité d'investissement dans le secteur. Pour les entreprises pétrolières et gazières, la question du coût du capital devient cruciale – la complexité du financement pourrait se refléter sur les projets d'exploitation de nouveaux gisements et de modernisation des raffineries. De plus, les taux de croissance de la production industrielle détermineront la dynamique de la demande en matières premières : si l'économie mondiale entre en stagnation, les prix du pétrole et du gaz pourraient rester sous pression. En revanche, toute mesure incitative (comme de nouveaux programmes d'investissement infrastructurels en Chine ou un assouplissement de la politique de la Réserve fédérale américaine) soutiendrait la demande en énergies et pourrait rétablir l'équilibre du marché.
Dans l'ensemble, les acteurs du marché énergétique terminent l'année 2025 en s'adaptant à de nouvelles réalités. Le face-à-face des sanctions entre la Russie et l'Occident continue de remodeler les flux commerciaux de pétrole, de gaz et de charbon. Les entreprises recherchent des moyens de couvrir les risques et explorent de nouveaux créneaux, qu'il s'agisse de la réorientation des exportations vers l'Asie, de la mise en œuvre de plateformes commerciales numériques ou du développement d'une transformation plus poussée des matières premières au sein du pays. Simultanément, la transition énergétique prend de l'ampleur : des investissements records dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique détermineront la configuration à long terme du secteur. Les mois à venir montreront à quel point il sera possible de passer les épreuves hivernales et d'assurer un équilibre des intérêts – des entreprises énergétiques aux consommateurs finaux – dans une année 2025 aussi complexe.