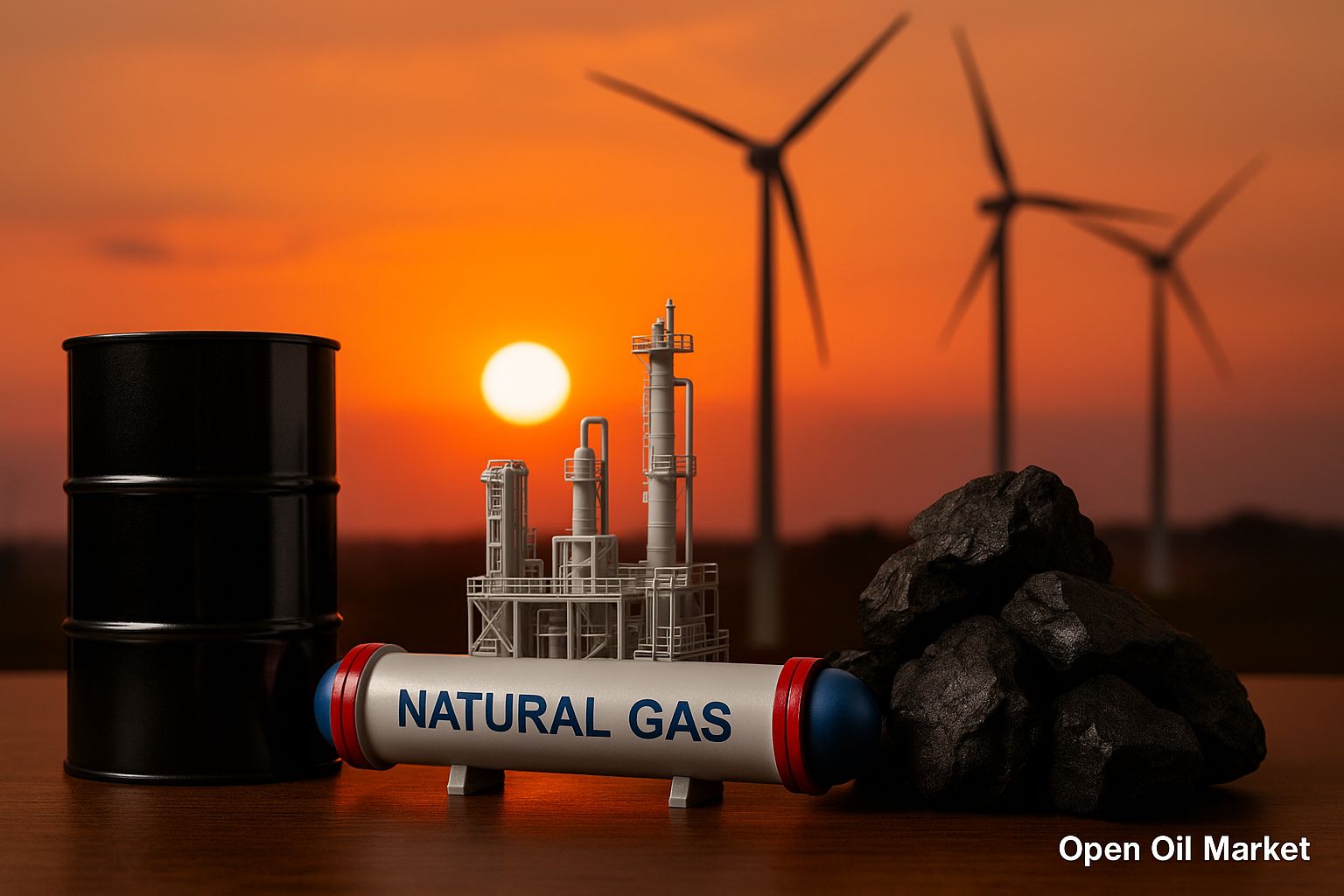
Principales nouvelles sur le secteur de l'énergie et des combustibles au 1er novembre 2025 : la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine a inspiré unoptimisme sur le marché pétrolier, l'Europe entre l'hiver avec des réserves de gaz record, et la confrontation des sanctions autour du secteur énergétique russe continue de s'intensifier.
Les événements actuels du secteur de l'énergie (TÉC) au 1er novembre 2025 se déroulent sur fond de tensions géopolitiques persistantes, mais des signaux positifs apparaissent prudemment sur les marchés. La confrontation des sanctions entre la Russie et l'Occident ne faiblit pas : les États-Unis ont mis en place cette semaine de nouvelles restrictions contre les plus grandes entreprises pétrolières et gazières russes, tandis que l'Union européenne ferme les dernières échappatoires pour contourner l'embargo (en approuvant le 19ème paquet de sanctions avec une interdiction progressive d'acheter du GNL russe). Néanmoins, l'économie mondiale a reçu une impulsion d'optimisme — le 30 octobre, les dirigeants américains et chinois sont parvenus à un accord de trêve commerciale, évitant une nouvelle escalade de la guerre tarifaire. La perspective d'un apaisement des relations entre les deux plus grandes économies a amélioré les prévisions de la demande mondiale en ressources énergétiques et soutenu l'optimisme sur les marchés des commodités.
De plus, les marchés des matières premières affichent une stabilité relative. Les prix du pétrole, qui avaient chuté à des niveaux faibles en plusieurs mois plus tôt cet automne, se maintiennent dans une fourchette modérée : le Brent se situe autour de 64–66 $ le baril, le WTI autour de 60–62 $. Les nouvelles sanctions récentes ont provoqué des fluctuations temporaires des cotations (le Brent dépassait 66 $), mais dans l'ensemble, l'équilibre entre l'offre et la demande reste fragile, avec une tendance à l'excédent. Le marché européen du gaz se prépare à entrer dans l'hiver avec des réserves de carburant record : les installations de stockage de gaz dans l'UE sont remplies à plus de 95%, ce qui offre une marge de sécurité avant la saison de chauffage et réduit les prix de gros à environ 30 € par MWh (bien en dessous des sommets de 2022).
La transition énergétique mondiale prend de l'ampleur — de nombreux pays enregistrent de nouveaux records de production d'énergie à partir de sources renouvelables, bien que la stabilité des systèmes énergétiques nécessite encore une dépendance vis-à-vis des ressources traditionnelles. En Russie, après une récente crise énergétique, les mesures d'urgence du gouvernement ont stabilisé la situation : la production d'essence et de diesel a été rétablie, les prix de gros ont baissé et les stations-service sont approvisionnées en carburant.
Ci-dessous, un aperçu des principales nouvelles et tendances dans les segments pétrolier, gazier, charbon, renouvelable et sur le marché des carburants à la date actuelle.
Marché pétrolier : équilibre excédentaire et risques dans le cadre de la trêve commerciale
Les prix mondiaux du pétrole restent sous pression en raison de facteurs fondamentaux, malgré des pics à court terme. Après avoir chuté à des niveaux bas en plusieurs mois cet automne, les cotations du Brent se stabilisent autour de 60 à 65 $ le baril — en dessous des niveaux de début d'année. Le marché s'attend à ce qu'à la fin de 2025, l'offre de pétrole dépasse la demande, soutenue par plusieurs tendances :
- Augmentation de la production face à un ralentissement de la demande. L'OPEP+ continue d'augmenter progressivement sa production : en octobre, les quotas ont été relevés d'environ 0,14 million de barils/jour, une mesure similaire est attendue en novembre. Parallèlement, les plus grands producteurs en dehors du cartel (États-Unis, Brésil, etc.) ont atteint des volumes record. En même temps, la consommation mondiale ralentit : l'AIE prévoit une augmentation de la demande en 2025 de seulement 0,7 million de barils/jour (en 2023, c'était plus de 2 millions). Une croissance économique modérée, les conséquences des précédents pics de prix et la montée des véhicules électriques limitent l'augmentation de la consommation de carburant.
- Risques géopolitiques et de sanctions. Le renforcement des sanctions contre la Russie freine une partie de ses exportations — les récentes mesures américaines concernant les compagnies pétrolières russes ont provoqué une hausse des prix du Brent au-dessus de 66 $, montrant l'influence des facteurs politiques. En revanche, l'absence de progrès dans le dialogue entre la Russie et les États-Unis maintient une incertitude. D'un autre côté, la trêve entre les États-Unis et la Chine a amélioré le sentiment du marché, renforçant les espoirs d'une demande stable. En fin de compte, les prix du pétrole restent dans une fourchette étroite sans tendance claire à la hausse ou à la baisse.
L'excédent d'offre empêche les prix du pétrole de connaître une véritable hausse. Les acteurs du marché agissent prudemment, se basant sur l'excédent, et seules des perturbations majeures pourraient faire revenir les cotations à une forte volatilité.
Marché du gaz : réserves record en Europe et approvisionnements flexibles
La situation sur le marché du gaz est favorable aux consommateurs, notamment en Europe. Le continent aborde l'hiver avec des réserves de gaz sans précédent : les installations de stockage de l'UE sont remplies à plus de 95 % de leur capacité. Un automne doux et un fort approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) ont permis d'accumuler de telles réserves sans urgences, stabilisant les prix de gros à un niveau bas. Les contrats à terme TTF se maintiennent autour de 30 € par MWh — bien en dessous des pics de 2022.
Le risque de revoir une crise des prix comme l'année dernière a considérablement diminué, bien que beaucoup dépende de la rigueur de l'hiver et de l'accessibilité du GNL. La Russie compense la perte du marché européen en se tournant vers l'Orient : les livraisons via "Power of Siberia" en Chine atteignent des volumes records et les préparatifs pour la construction de "Power of Siberia - 2" sont en cours, augmentant les expéditions de GNL russe vers l'Asie.
Dans l'ensemble, le secteur mondial du gaz aborde le début de l'hiver avec une solide marge de sécurité. Les réserves record de l'Europe et la flexibilité des approvisionnements mondiaux en GNL permettent d'espérer des prix stables pour les mois à venir. S'il n'y a pas de froid extrême ou d'autres situations d'urgence, le marché devrait rester équilibré et confortable pour les consommateurs. Néanmoins, les acteurs continuent de surveiller la météo et la demande asiatique pour le GNL, conscients que les circonstances peuvent évoluer.
Géopolitique : renforcement des sanctions et position de l'Asie
Octobre a apporté une nouvelle vague de pression sur le secteur énergétique russe en l'absence de progrès dans le dialogue entre Moscou et l'Occident. Les États-Unis ont élargi les sanctions contre les principales entreprises pétrolières et gazières russes et les transporteurs d'énergie, tandis que l'UE a approuvé le 19ème paquet de sanctions (avec l'interdiction progressive du GNL russe) et un plan visant à se passer complètement du gaz russe d'ici 2026. En réponse, la Russie renforce sa coopération avec l'Est et promet de réorienter ses exportations vers des pays amis.
L'Inde et la Chine, les plus grands importateurs, continuent d'acheter du pétrole et du gaz russes à des prix très réduits, demeurant des marchés clés pour la Russie. Malgré la pression occidentale pour réduire la dépendance à Moscou, ces pays ne sont pas prêts à compromettre leur sécurité énergétique. Parallèlement, ils augmentent leur production interne et les infrastructures (terminaux GNL, entrepôts) pour l'avenir. Les États-Unis tentent d'attirer les géants asiatiques : dans le cadre de la trêve commerciale, la Chine a accepté d'augmenter ses importations d'énergie américaine. Cependant, à ce stade, l'Inde et la Chine conservent des liens étroits avec la Russie, restant des acheteurs essentiels de ses ressources énergétiques.
Transition énergétique : records des ENR sur fond de rôle de l'énergie traditionnelle
La transition vers une énergie propre prend de l'ampleur. En 2025, des capacités record de centrales solaires et éoliennes entrent en exploitation, et la part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité a pour la première fois surpassé celle du charbon. Les investissements dans l'énergie verte ont atteint un maximum historique grâce à des programmes gouvernementaux. Malgré tout, le pétrole, le gaz et le charbon restent la base de l'approvisionnement énergétique — en particulier pour l'industrie et les transports. La stabilité des systèmes énergétiques est encore garantie par des centrales à gaz et à charbon traditionnelles, compensant la variabilité du soleil et du vent. Les gouvernements et les entreprises augmentent leurs investissements dans les accumulateurs d'énergie et les technologies hydrogène, mais atteindre la neutralité carbone demeure un défi des prochaines décennies et nécessitera une modernisation des infrastructures.
Marché du charbon : demande en Asie et abandon du charbon en Occident
Des tendances opposées se dessinent sur le marché du charbon. En Asie, la demande reste élevée : cet été, une chaleur extrême a entraîné une augmentation de la production de charbon et une hausse des prix (les cotations du charbon en Australie ont grimpé à des niveaux records). Les exportateurs ont augmenté leurs livraisons, stabilisant les prix à l'automne. Parallèlement, les pays développés accélèrent leur abandon du charbon : la part de la production de charbon dans l'UE est passée en dessous de 10 %, certains États prévoient de fermer leurs centrales à charbon au cours de cette décennie. Aux États-Unis, le gaz bon marché et la forte croissance des ENR évincent le charbon du secteur énergétique. En conséquence, les prix mondiaux du charbon sont nettement inférieurs aux niveaux de l'année dernière, reflétant un affaiblissement de la demande en dehors de l'Asie.
Marché russe des carburants : stabilisation et contrôle strict
Après la crise énergétique estivale, les autorités russes ont pris des mesures strictes pour normaliser le marché intérieur. L'interdiction d'exporter de l'essence a été prolongée (jusqu'à fin 2025) et les exportations de diesel sont strictement limitées. Des compensations sont versées aux raffineries pour réorienter le carburant vers le marché intérieur, et les prix dans les stations-service sont sous un contrôle renforcé (sans gel direct). Ces mesures ont permis, fin octobre, de restaurer la production et les livraisons d'essence et de diesel à un niveau normal. Le gouvernement compte passer l'hiver sans interruptions et, face à la menace de pénurie, est prêt à rétablir rapidement les restrictions à l'exportation. Cependant, pour assurer une stabilité à long terme, des investissements dans l'infrastructure de stockage et de distribution de carburant sont nécessaires, ainsi qu'une modernisation du raffinage du pétrole — des mesures d'urgence à elles seules ne résoudront pas le problème.
Prévisions et perspectives : optimisme prudent avant l'hiver
D'ici la fin de 2025, le secteur énergétique s'adaptera aux nouvelles réalités. La confrontation des sanctions a radicalement modifié les routes d'approvisionnement : l'Europe a presque supprimé les importations de gaz russe et a considérablement réduit celles de pétrole, tandis que la Russie a réorienté ses exportations vers l'est, renforçant sa coopération avec l'Asie. En même temps, des facteurs fondamentaux sont favorables aux consommateurs : l'offre de pétrole et de gaz couvre la demande (les réserves sont pleines, la production est à un niveau élevé, la hausse de la consommation s'est ralentie), ce qui stabilise les prix à des niveaux modérés — bien en dessous des sommets des années précédentes.
La prévision prudemment optimiste pour l'hiver suppose l'absence de chocs majeurs. S'il n'y a pas de froid extrême ni de nouvelles crises, le marché pétrolier conservera un excédent et des prix bas, tandis que les réserves de gaz record empêcheront les prix du gaz d'augmenter fortement même en cas d'augmentation de la consommation. Pour les investisseurs et les entreprises du secteur, cette situation signifie des conditions de travail plus prévisibles, bien que la rentabilité des activités soit actuellement inférieure à celle des périodes de boom des matières premières. Néanmoins, des risques subsistent : l'intensification des conflits, de nouvelles sanctions ou des accidents technologiques pourraient perturber l'équilibre. De plus, l'accélération de la transition énergétique réduira progressivement la demande de combustibles fossiles, et les entreprises du secteur énergétique doivent se préparer à des changements structurels.




